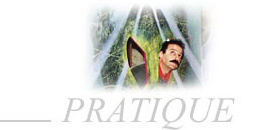Une peinture rectoversée est-elle plutôt une peinture ou plutôt
une sculpture ? Est-elle les deux à la fois ? Pour notre part,
c’est sans ambiguïté que nous la situons dans le domaine bidimensionnel.
Les nombreux va-et-vient entre peinture et sculpture et vice-versa
qui ont marqué la mise au point de la Rectoversion correspondent
à ce désir d’innover sans pour autant cesser de peindre comme
l’avant-garde désormais académique le proclame. Si la Rectoversion
est née à l’extrême fin du XX°siècle, c’est bien dans le XXI°siècle
qu’elle trouvera son épanouissement.
Les expérimentations qui suivent sont des exemples des différentes
oscillations entre les modes bi et tridimensionnels qui ont marqué
sa genèse, de 1978 à 1992.
Le passage minimaliste s’est avéré nécessaire mais, dès 1992,
les deux faces peintes entretiennent une relation de différence
et non d’identité.
Par ailleurs, le rôle tenu par la troisième face s’affirme au
fil des années, ce qui confirme définitivement le caractère ternaire
d’une peinture rectoversée. C’est pourquoi elle est bien plus
éloignée du double-face « traditionnel » que l’on pourrait le
croire. En tout état de cause, son champ d’expérimentation reste
vierge.
Le postulat de la Rectoversion aura été de mettre à jour le verso
puis de proposer une composition inédite tout en restant dans
la stricte bidimensionnalité. Il est vrai que la troisième face
est son côté le plus énigmatique et certainement le plus difficile
non seulement à appréhender mais aussi tout simplement à voir.
On ne troue pas impunément le visible !